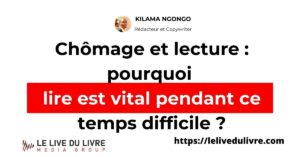Nous sommes en pleine période de rentrée littéraire et des articles sur les “meilleurs” livres de la période circulent.
D’un média à l’autre, un échantillon de titres présentant les livres à ne pas manquer nous est présenté parmi les 486 qui paraitront.
Puisque en matière de goûts et de lectures, nos choix sont toujours discutables, est-il commode de parler de “meilleurs” ?
Un livre peut être le meilleur pour un lecteur lambda, et être ennuyeux pour un autre car cela dépend des habitudes individuelles.
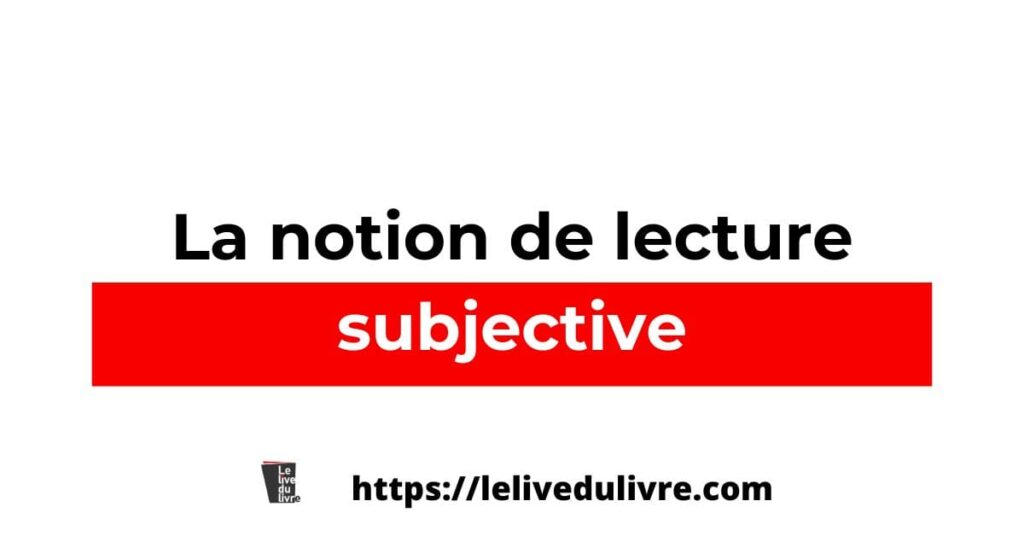
La lecture subjective
Que faut-il entendre par lecture subjective ?
Brigitte Louichon nous en parle comme étant un exercice de lecture des textes littéraires.
Sa finalité est la formation du sujet lecteur. L’expression subjective et le questionnement des interprétations en sont les modalités.
Selon Langlade (La lecture subjective. Québec français, 145, 71-73.), c’est une étude de la façon dont le lecture affecte (émotions, sentiments, jugements) un lecteur.
La lecture subjective est une explication de l’interaction entre le lecteur et le texte en tenant compte de ses goûts et de ses habitudes.
Ce dialogue avec le texte est à la fois intime et individuel car chaque personne l’effectue selon sa personnalité profonde, sa culture intime et même son imaginaire.
“L’Homme est la mesure de toute chose” selon Protagoras, car il est guidé par ses expériences et perceptions individuelles ?
La lecture subjective et le plaisir de la lecture
Au cœur de cet engouement, la notion de plaisir de la lecture s’impose car c‘est elle qui influencera le choix.
Par plaisir, je parle de cet élan de facilité qui rend un livre plus attachant que l’autre sans vraiment comprendre pourquoi.
Cette notion s’applique à presque tout ce que nous consommons : livres, BD ou même films.
La notion de plaisir précède celle de lecture subjective. Ensemble, ces deux notions sont déclencheurs de l’attention que le lecteur portera au texte.
Quel est votre livre préféré de la rentrée ? On ne sait jamais, peut-être que nos goûts pourront se croiser.